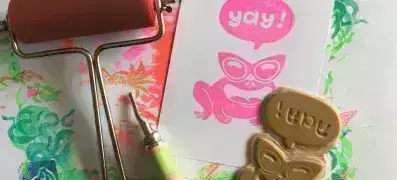Frank Tétart, géopolitologue : « Les frontières ne sont pas prêtes de disparaître »
Publié le 28 août. 2025
Dernière mise à jour 28 août. 2025
Du 8 septembre au 12 octobre, l’espace Cosmopolis organise « Décryptages », un mois d'animations autour de la question des frontières. Invité de cette édition, le géopolitologue Frank Tétart, co-auteur du Dessous des cartes sur Arte, revient sur les évolutions de cet outil politique.
Les frontières sont aujourd’hui un incontournable géopolitique. Ont-elles pour autant toujours existé ?
Dès que l’Homme s’est sédentarisé, une première forme de frontières défensives a été érigée pour protéger les richesses produites des convoitises des voisins. Mais pendant des siècles, le concept de frontières est resté assez flou. Les limites des grands empires étaient ainsi appelées des « confins ». Il s’agissait de bordures lointaines, protégées soit par des garnisons de soldats (souvent issus des populations minoritaires d’ailleurs) soit par des obstacles naturels.
Le cas de figure typique, ce sont les Romains. Ils s’appuyaient sur le Rhin, le Danube, le Sahara ou les espaces désertiques de Judée pour protéger le limes, l’espace délimitant ce qui était sous contrôle de l’empire et ce qui ne l’était pas (les contrées barbares). Il faut attendre l’émergence et le développement des États-nations, au cours du XIXe siècle, pour voir les frontières se figer et devenir clairement matérialisées.
À quoi les frontières servent-elles alors ?
Leur rôle est double : elles permettent tout d’abord aux États de lever l’impôt et de définir un espace dans lequel leurs institutions peuvent faire valoir leurs prérogatives. Progressivement, elles ont aussi vocation à différencier des espaces aux identités différentes, parfois exaltées au profit d’un sentiment national. Elles deviennent ainsi un « baromètre » de l’état d’entente entre deux pays.
Notons que malgré cette solidification des frontières, cela ne signifie pas pour autant que celles-ci deviennent des objets imperméables, et que les sociétés d’alors n’intègrent pas des personnes venant de l’extérieur. La nation n’est pas en effet qu’un espace linguistique, ethnique ou religieux, c’est aussi un ensemble politique d’adhésion à des valeurs et des projets communs. Une conception traditionnellement portée par la France.
Comment les frontières ont-elles évolué au cours du XXe siècle, notamment en Europe ?
Elles ont d’abord fait l’objet de nombreux contentieux entre États. La guerre franco-prussienne de 1870 en est un exemple frappant, avec un différend prononcé autour de l’Alsace-Lorraine. Passées les deux Guerres mondiales, les puissances européennes se mettent d’accord, à travers les Accords de Yalta et de Potsdam, sur un principe cardinal du droit international : l’intangibilité des frontières, c’est-à-dire leur permanence dans le temps.
La fin du XXe siècle a ainsi vu une relative stabilisation des frontières, même si ce principe d’intangibilité s’oppose à un autre pilier du droit international qu’est la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes. L’éclatement de l’ex-Yougoslavie avec les guerres serbo-croate, en Bosnie et au Kosovo, puis la création d’États-nations est symptomatique de ce hiatus.
L'effondrement du bloc soviétique a laissé croire que les frontières allaient disparaître au profit d’un monde ouvert. Comment expliquer le retour en force des frontières ?
Au tournant des années 90, le libéralisme économique et l’extension de la mondialisation ont en effet constitué l’horizon d’un monde sans frontières. On le voit en Europe avec la création au milieu des années 90 de l’Espace Schengen, cette vaste zone au sein de laquelle 450 millions d’habitants peuvent aujourd’hui circuler sans contrainte. Cette liberté, qui existait jusqu’alors pour la circulation des marchandises, devenait tangible pour les personnes, c’était inédit.
Mais depuis une vingtaine d’années, on voit effectivement le retour des frontières à travers le monde. Partout, des murs sont érigés. La bascule s’opère, selon moi, après les attentats du 11 septembre 2001. Pour la première fois, les Américains se rendent compte de leur fragilité, notamment face aux nouvelles menaces du terrorisme. Les différentes crises de ce début de siècle (économique, politique, migratoire…) ont renforcé la volonté d’imperméabilisation des frontières, en même temps que la remise en cause, entre États et au sein des États, de ces espaces. On le voit avec les conflits opposant le Cambodge et le Laos, l’Inde et le Pakistan ou ailleurs dans le monde (contentieux entre l’Algérie et le Maroc au sujet du Sahara occidental, ou la Serbie et le Kosovo…).
Parallèlement, les frontières, que l’on croyait un concept dépassé, ont également su montrer leurs vertus dans des contextes de menaces économiques ou sanitaires par exemple - on l’a bien vu à l’occasion de la crise du Covid-19.
Quel est l'avenir des frontières ?
Elles ne sont pas prêtes de disparaître. Pour parler de celles qui nous entourent, en Union européenne, elles se renforcent, à l’extérieur et même à l’intérieur de l’espace Schengen, avec en parallèle, des discours politiques aux accents populistes qui instrumentalisent leur rôle, leur attribuant tous les mérites.
Pourtant, l’étanchéité parfaite n’est ni possible, ni souhaitable. Les Européens, tout comme les Coréens ou les Japonais, sont en effet confrontés à un problème démographique majeur. La question de l’ouverture maîtrisée des frontières - ce qui ne signifie pas leur suppression - se pose donc pour faire fonctionner les États à long terme.
« Frontières, le retour ? ». Une conférence de Frank Tétart.
Vendredi 19 septembre, à 18 h 30, à Cosmopolis.
Entrée libre et gratuite. Co-organisée par la librairie La Géothèque.
À Cosmopolis, un mois pour débattre des frontières
Chaque année, au mois de septembre, l’espace international de la Ville de Nantes programme un mois de débat et de rencontre autour d’une question de société. Après la mort et les rites funéraires en 2024, Cosmopolis s’interroge cette fois-ci sur la notion des frontières. Le tournant du 21e siècle et ses multiples crises (migratoires, géopolitiques, écologiques…) ont en effet vu refleurir partout dans le monde, les murs, qu’ils soient réels ou symboliques, à la fois entre nations et au sein même des États.
Durant un mois, du 8 septembre au 12 octobre, Cosmopolis invite chercheurs, artistes et grands témoins de la société civile pour débattre et prendre de la hauteur sur ces enjeux. Au programme : conférences, expositions, ateliers et projections.